
Soigner les yeux : un défi passionnant !
Du diagnostic au traitement et à la recherche, l’ophtalmologie est une discipline riche et complexe.
Organe de la vue, mais aussi fenêtre sur le monde et les émotions, l’œil requiert une attention particulière. L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin réunit toutes les spécialités sous son toit, pour assurer l’accompagnement le plus complet possible des patients et patientes souffrant d’atteinte visuelle, de la naissance à un âge avancé.
L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin est un lieu entièrement dédié à la santé de l’œil. Tous ses services et les 13 unités spécialisées sont dévolus à cet organe complexe qui requiert des soins spécifiques en fonction des zones atteintes par une lésion ou une maladie. Ainsi, des unités se consacrent exclusivement à la cornée, à la rétine, ou encore à la diabétologie. Sans oublier le service des urgences et la policlinique.
Tous ces pôles spécialisés impliquent un nombre conséquent de métiers différents. Parmi eux, les médecins ophtalmologues – évidemment – qui posent les diagnostics et évaluent les traitements nécessaires, en collaboration avec les équipes soignantes. L’optométriste constitue également l’un des piliers des consultations en ophtalmologie. « Ce spécialiste mesure les divers paramètres de la vision et détermine les besoins en correction visuelle. Sa mission est aussi de réaliser les différents examens complémentaires grâce auxquels la ou le médecin posera un diagnostic. Ce rôle, primordial, est assez récent. Désormais un grand nombre de tâches peuvent en effet lui être déléguées par le ou la médecin assistante », explique le Dr Matthieu Barrali, responsable de la policlinique et des urgences de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin.
Une autre nouveauté en cours d’implantation à l’Hôpital ophtalmique concerne la profession d’infirmier ou infirmière de pratique avancée. Aux urgences, face à des maladies sans gravité, il ou elle pourra prochainement établir en toute autonomie le diagnostic et aller au bout de la consultation sans avoir besoin d’une validation médicale supplémentaire. Une avancée précieuse pour désengorger les urgences et accélérer la prise en charge de la patientèle atteinte de troubles bénins.
L’importance de l’interdisciplinarité en ophtalmologie
Indispensable pour prodiguer des soins complets et de qualité, l’interdisciplinarité est le maître-mot lorsqu’il s’agit de soigner les yeux. Ainsi, à côté des médecins, des optométristes et des équipes infirmières, il faut mentionner également les orthoptistes (dont le rôle consiste notamment à rééduquer la vision lors de troubles tels que le strabisme), les photographes en ophtalmologie (lire encadré), les équipes de recherche, les généticiens et généticiennes, ou encore les spécialistes en basse vision ou les psychologues. En effet, une consultation de conseil et soutien psychologique a vu le jour au printemps 2024, au sein de la Fondation Asile des aveugles. Son but : venir en aide aux personnes pour qui la déficience visuelle a d’importantes répercussions sur le plan mental. « Cette nouvelle consultation s’inscrit dans une démarche de prise en charge plus globale de la personne. Quiconque ressent le besoin d’un soutien psychologique peut y prétendre. Tous et toutes les professionnelles de santé – exerçant à l’hôpital ou en ville – peuvent nous adresser des patients et des patientes. Notre objectif est de les aider à accepter la situation et à surmonter les difficultés », explique Olivia Lempen, docteure en psychologie. Les locaux de ce nouveau service se situent dans les bureaux de PORTAILS, le service de psychologie, d’orientation et de formation professionnelles de la Fondation. Si la plupart des personnes se rendent sur place pour bénéficier des séances de soutien (une à dix, selon les besoins), les psychologues se déplacent également au chevet de celles et ceux qui sont hospitalisés. « Outre l’aide psychologique, nous orientons également les personnes vers d’autres services pour mettre en place des aménagements ou une réorientation professionnelle, entre autres. Nous proposons aussi de rencontrer les proches afin de pouvoir parler sereinement des implications de l’atteinte au quotidien », poursuit l’experte. Depuis sa mise en place, ce service a déjà apporté son aide à une vingtaine de personnes et la demande ne cesse d’augmenter. Il emploie actuellement deux psychologues.

Docteure en psychologie
Défis futurs
La santé des yeux de la population vieillissante est l’un des enjeux majeurs de l’ophtalmologie. « Aujourd’hui, les traitements évoluent rapidement pour la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et le glaucome, par exemple. Ils sont de plus en plus personnalisés et bénéficient des progrès de la génétique », explique le Dr Barrali.

Responsable de la policlinique
Le rôle des médecins généticiens est désormais indissociable de la prise en charge globale de la santé des yeux. « Les maladies génétiques qui touchent les yeux peuvent être dues à un seul gène qui dysfonctionne ou à plusieurs variations de plusieurs gènes. À titre d’exemple, rien que pour la rétine, plus de 300 d’entre eux peuvent ainsi être concernés et causer des dommages. Identifier lesquels sont impliqués dans la maladie d’un ou d’une patiente aide à mieux cibler les traitements. Un dépistage génétique chez des personnes dont plusieurs membres de la famille ont développé une DMLA, par exemple, permet d’évaluer les risques de développer la maladie et de prendre les mesures nécessaires afin d’en prévenir l’apparition », explique le Dr Hoai Viet Tran, responsable de l’unité d’oculogénétique et thérapie génique.
La médecine personnalisée de demain passera ainsi forcément par un diagnostic moléculaire afin d’examiner les gènes potentiellement altérés. « La thérapie génique va de plus en plus faire partie de l’arsenal thérapeutique que nous avons à disposition », poursuit le Dr Tran. Et de préciser : « L’œil est un organe propice à ce type d’approche. Isolé dans son orbite, il est facilement atteignable par le biais d’une chirurgie très ciblée et rend possible l’injection d’une quantité minime de produit thérapeutique en ciblant précisément les cellules à traiter. »

Responsable de l’unité d’oculogénétique et thérapie génique
Enfin, la prévention contre les différents troubles de la vision est aussi un axe clé de l’ophtalmologie, à l’instar de l’épidémie de myopie qui touche de plus en plus les jeunes. Dépistages, campagnes d’information et autres actions visent à sensibiliser la population à l’intérêt de ne pas négliger sa santé visuelle. Et le Dr Barrali de conclure : « Sans oublier l’intelligence artificielle qui fera de plus en plus partie du quotidien des ophtalmologues tant elle peut apporter une aide efficace à la profession. » Elle a en effet la faculté d’analyser et de recouper très vite et efficacement des données et est de plus en plus utilisée dans la recherche, notamment.
Profession « photographe en ophtalmologie »
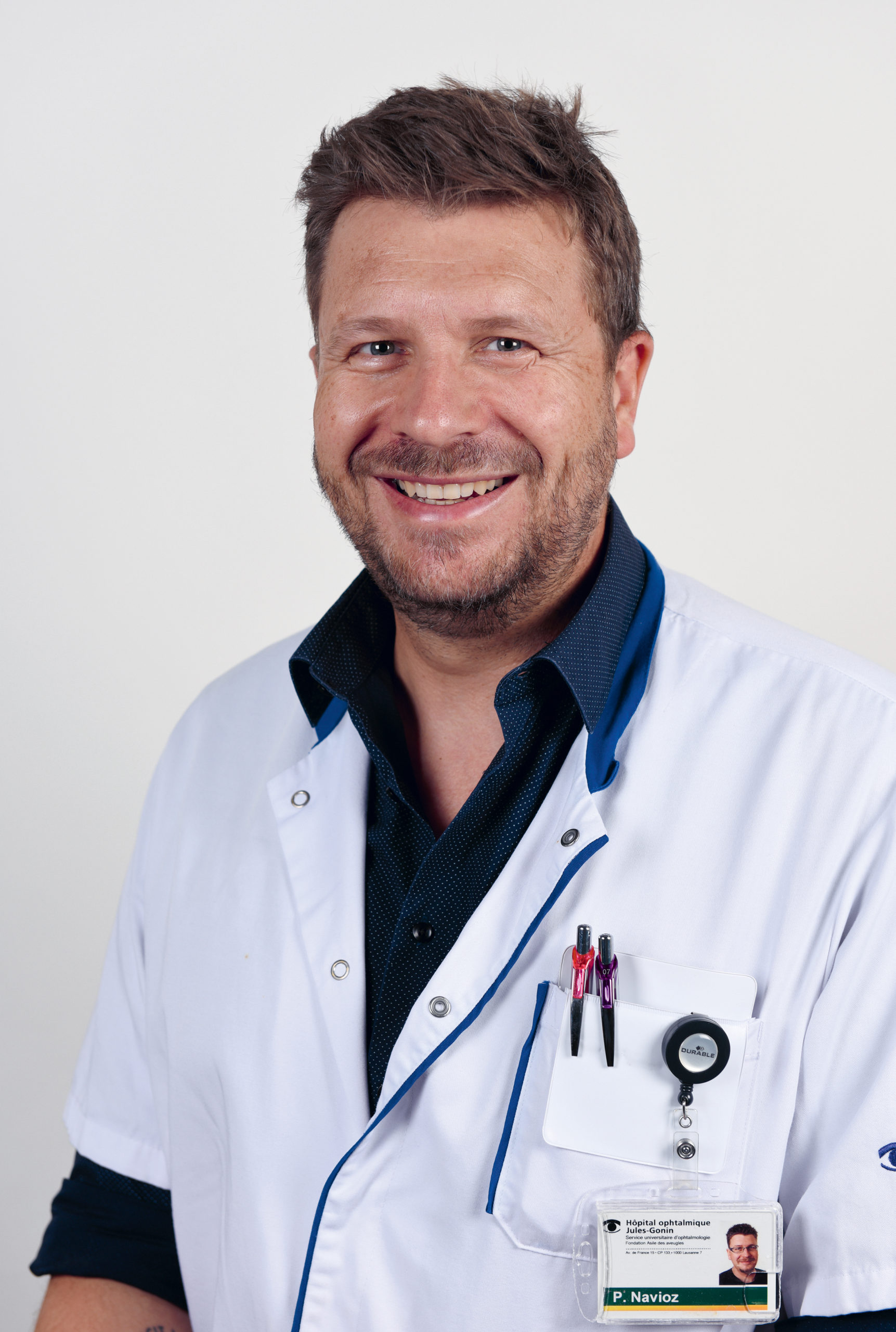
Responsable du centre d’imagerie
Peu connu, c’est un métier qui fait se rencontrer la passion des images et le monde des soins. « Il n’existe pas de formation fédérale pour devenir photographe en ophtalmologie. Lorsque j’ai débuté dans ce domaine, il y a une vingtaine d’années, nous apprenions sur le tas. Depuis environ dix ans, l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin dispense une formation interne qui se déroule sur quatre ans », explique Pierre Navioz, responsable du centre d’imagerie de l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin qui emploie aujourd’hui quatorze photographes à temps partiel.
Pour embrasser une telle carrière, il faut d’abord être photographe de profession. Les connaissances relatives à la prise de vue sont indispensables pour pouvoir se lancer en imagerie ophtalmique. « Nous réalisons des examens du segment antérieur de l’œil pour voir l’iris, le cristallin ou la conjonctive, ainsi que des images de l’intérieur de l’œil et des angiographies (technique permettant de visualiser les vaisseaux sanguins grâce à l’injection d’un produit de contraste, ndlr). Aider les médecins dans la pose d’un diagnostic et participer au traitement des maladies en capturant des images de haute qualité est très valorisant », poursuit Pierre Navioz. Installé à Lausanne, le centre d’imagerie a également une antenne à l’Hôpital Riviera-Chablais de Rennaz. « Chaque année, nous réalisons plus de 7 ’000 images de fond de l’œil. Nous avons la capacité d’accueillir jusqu’à 70 patients et patientes par jour », conclut-il.
Place (aussi) à la recherche en ophtalmologie
Chaque année, un grand nombre d’études permettent de faire avancer les connaissances sur les maladies oculaires, mais aussi de tester de nouvelles technologies et des traitements inédits.
La Prof. Chiara Eandi, responsable de l’unité de rétine médicale à l’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, travaille en tant que médecin clinicienne. Elle chapeaute également plusieurs projets de recherche : « Je collabore, par exemple, avec le laboratoire du Dr ès sc. Raphaël Roduit, qui travaille sur la dégénérescence maculaire et sur la rétinopathie diabétique. Je mène également une étude avec l’aide du Dr ès sc. Mattia Tomasoni, responsable de la Plateforme de recherche en imagerie oculaire RIO. Nous utilisons l’intelligence artificielle pour analyser des centaines d’images afin de trouver certains biomarqueurs de maladies. Je supervise aussi certains travaux sponsorisés par des laboratoires pharmaceutiques pour tester de nouveaux traitements. »
À L’Hôpital ophtalmique Jules-Gonin, les équipes de recherche peuvent compter sur l’aide du Centre d’investigation clinique (CIC). « Il s’agit d’une plateforme de soutien qui garantit la mise en place et la conduite des projets selon les bonnes pratiques et la réglementation en vigueur. L’équipe s’assure de leur faisabilité, vérifie la disponibilité des ressources nécessaires, tant au niveau des compétences que des infrastructures. Nous nous occupons également des contrats, de la soumission au comité d’éthique et du bon déroulement des investigations cliniques et médico-techniques qu’exige le protocole », explique Aurélia Gryczka Moyemont, responsable du CIC.
En 2025, huit recherches sur de nouveaux traitements et dispositifs médicaux proposés par les entreprises pharmaceutiques ont ainsi débuté, ainsi que sept études académiques menées par des médecins de l’Hôpital ophtalmique.
L’œil, aussi une fenêtre sur d’autres maladies
Parfois, une inflammation de l’œil peut cacher une pathologie systémique, autrement dit une maladie qui affecte plusieurs organes ou systèmes du corps. Les troubles oculaires tels qu’une diminution de la vision ou la présence de corps flottants, tout comme des rougeurs ou une intolérance à la lumière (photophobie) sont des symptômes à prendre en compte. « Les uvéites, par exemple, sont des inflammations de l’intérieur de l’œil. Elles peuvent être dues à des maladies infectieuses, comme la syphilis, la tuberculose ou encore la toxoplasmose, mais aussi être causées par une maladie auto-immune ou une maladie inflammatoire chronique. L’examen de l’œil permet des observations cliniques précises », explique la Dre Florence Hoogewoud, médecin cadre à l’unité d’immuno-infectiologie et spécialiste des uvéites.
Il est très courant qu’une pathologie générale puisse être diagnostiquée à travers une manifestation ophtalmologique. Parmi les plus fréquentes : la sarcoïdose (qui touche principalement le système respiratoire), la maladie de Behçet (qui se manifeste aussi par des ulcères de la bouche et des parties génitales), la polyarthrite rhumatoïde, entre autres. « Les maladies infectieuses se soignent avec des antibiotiques ou des antiviraux. Pour les pathologies inflammatoires, on a recours à des traitements qui modifient l’immunité (stéroïdes, immunosuppresseurs, etc.). Un suivi sur le long terme est préconisé pour s’assurer de la bonne réponse aux médicaments et de l’absence de récidive à l’arrêt du traitement », poursuit la spécialiste.

Nous avons modifié l’article original pour en faire une version web.
